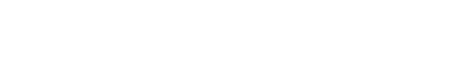1992 Alfred Berchtold

Né a Zurich en 1925, il passe son enfance à Paris (Montmartre). Ramené à Zurich par la guerre en 1940, il vient en 1944 à Genève, attiré par l'enseignement de Marcel Raymond. Fixé dans cette ville, il s'y voue à l'enseignement secondaire puis universitaire. La Suisse romande au cap du XXe siècle paraît en 1963 sous forme de thèse, précédée et suivie d'autres écrits, consacrés pour la plupart, comme ses chroniques journalistiques et ses conférences, à l'histoire intellectuelle et artistique du pays, dans ses relations avec l'Europe. Après la parution de Bâle et l'Europe, il reçoit entre autres les prix Oertli, Brandenberger, Sigpa-Europe, le Prix quadriennal de littérature de la Ville de Genève, ainsi qu'un doctorat honoris causa de l'Université de Lausanne.
In Anerkennung seines unablässigen Bemühens um die schweizerische Kultur in allen ihren Ausdrucksformen.
Laudatio
Renate Böschenstein
Au mois de mai de cette année, on pouvait lire, en grands caractères sur des panneaux affichés dans la ville de Genève, une formule stimulant l'imagination tout autant que la réflexion: «Le pont: réalité et symbole.» C'était là le titre d'un cycle de conférences, données par Alfred Berchtold, mais cet intitulé pourrait également être rapporté, comme une devise, à toute son activité de chercheur et d'enseignant.
Jetant tout d'abord un pont entre les domaines de la littérature et de l'histoire, - effort rare et précieux à une époque de spécialisation —, vous vous êtes en effet proposé, cher monsieur Berchtold, de refuser le fossé entre les différentes parties de notre pays, et de démontrer une unité profonde, en particulier entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. C'est la grande tâche à laquelle vous avez consacré votre vie et vos forces: approfondir, sur le plan intellectuel, la connaissance que l'une de ces régions possède de l'autre, et cela par des ouvrages combinant à la fois la solidité et l'exigence scientifiques, et une façon de présenter les grands thèmes de l'histoire, de la culture et de la littérature helvétiques qui sache attirer et enthousiasmer un public plus vaste que les seuls universitaires.
Les échos chaleureux, enthousiastes, que vos écrits et vos conférences ont suscités, ont prouvé que cet effort a été couronné d'un succès exceptionnel. Même hors des frontières de la Suisse, on perçoit le rayonnement de l'image que vous avez su peindre de la culture helvétique.
L'étranger... Il y a un lien très étroit entre l'histoire du Prix que M. Berchtold reçoit aujourd'hui et la personnalité de son destinataire. Si le Prix est lui-même le fruit d'une ancienne recherche effectuée par un Suisse de l'étranger (l'invention de la cellophane par M. Brandenberger), il se trouve que M. Berchtold a précisément profité des conditions que lui offraient un enfance et une première jeunesse vécues avec ses parents suisses à Paris: le résultat, c'est la combinaison réussie entre un bilinguisme naturel et une intime connaissance de la culture française, qui constitue l'un des fondements de son activité médiatrice. C'est certainement grâce à cette initiation précoce au monde francophone que Genève devait devenir plus tard, non seulement la ville où Alfred Berchtold fit ses études universitaires, mais encore le haut-lieu de sa vie et de son travail. Dès le début, l'enthousiasme pour la recherche allait de pair chez lui avec un véritable Eros paidagogikos qui mena le jeune homme de lettres dans plusieurs institutions genevoises —parmi elles l'Institut des sciences de l'éducation — pour le faire aboutir dans cet enseignement universitaire dont il reçut la charge en 1968, dans le cadre du Département d'histoire générale.
Si l'on peut dire que «tout Genève» connaît le nom d'Alfred Berchtold, c'est d'abord grâce à ses cours consacrés à l'histoire des cultures, des mentalités et des grandes personnalités suisses: car il a réussi — et c'est une réussite difficile dans un monde où les intérêts principaux ne sont plus orientés dans la direction de la culture — à attirer et à fasciner, en plus des étudiants, un nombre extraordinaire d'auditeurs et d'auditrices réguliers, venus de la Cité.
C'est également rare qu'une personnalité tellement portée vers la communication orale, vers le contact direct, vers l'art de l'éloquence, éprouve le fervent désir et trouve l'énergie d'accomplir en même temps une oeuvre écrite aussi importante. Je me garderai bien de vous lire la liste entière des publications de M. Berchtold: cette seule lecture nous retiendrait jusqu'à l'après-midi. Je me bornerai à caractériser les deux ouvrages qui sont de véritables monuments.
Le premier, devenu depuis longtemps ce qu'on appelle un «classique», donne une image à la fois panoramique et synthétique de la vie intellectuelle de la Suisse romande à une époque où celle-ci devenait particulièrement importante pour tout le pays: La Suisse romande au cap du XXe siècle. Portrait littéraire et moral. C'est un livre de presque mille pages, qui reste considéré encore aujourd'hui comme le livre de référence le plus digne de confiance dans le domaine en question. Le lecteur y trouve un éventail de matières très variées. Il peut s'instruire sur la situation de la théologie et des différentes églises, sur la philosophie, la psychologie, la poésie, le roman, le théâtre, la politique, la vie sociale. Il trouve également des informations sur les relations que la Suisse romande entretenait avec l'étranger ou sur ses grands voyageurs. Ce ne sont pas moins de soixante personnalités dont l'auteur a esquissé le portrait intellectuel. On connaît les difficultés auxquelles, aujourd'hui, le chercheur se trouve confronté, s'il ose entreprendre une monographie avec une telle ambition de totalisation. M. Berchtold ne s'est pas laissé intimider: son second chef-d'oeuvre, lui aussi, se libère des contraintes de la spécialisation. Fruit d'un travail continu de vingt ans, fruit aussi du sacrifice, puisqu'Alfred Berchtold renonça à quelques années d'enseignement où il aurait pu encore se consacrer à son public tant aimé, ce second livre présente le développement et le destin d'un très grand centre culturel, la ville de Bâle. Bâle et l'Europe. Une histoire culturelle constitue un ouvrage qui, sur le seul plan quantitatif, est aussi important que le premier. Paru en 1990, ce livre a déjà connu une deuxième édition.
Nous tous qui sommes réunis ici avons pu constater par quelles faveurs exceptionnelles cet ouvrage fut accueilli par la presse. Si le livre de Carl Schorske sur Vienne à la fin du XIXe siècle avait été lui aussi admiré en son temps pour sa présentation d'une matière extrêmement riche, combien plus vaste encore était la matière à laquelle M. Berchtold devait se confronter! A nouveau, nous découvrons le motif du «pont» dans la structure même du livre: si d'une part l'individualité singulière de la ville de Bâle est mise en relief, l'auteur porte également, d'autre part, une attention aiguë à la fonction exemplaire que remplit cette ville en tant que centre intellectuel inscrit dans une Europe des échanges.
Ce sont quinze siècles qui se déroulent devant les yeux du lecteur, et le coeur de cette période est la centaine d'années qui sépare le concile de Bâle de la mort d'Erasme, c'est-à-dire la grande époque de l'humanisme et de la Réforme. Par quel moyens écrits l'auteur captive-t-il le lecteur confronté à une telle richesse d'information? D'une part il est offert au lecteur de se promener dans une sorte d'allée d'arcades: ce sont autant d'arcs établis par l'auteur, l'intérieur de chacun de ses grands chapitres (par exemple: «Réforme»; ou «Médecine») entre des thèmes correspondant les uns avec les autres: c'est le cas entre la célèbre danse macabre bâloise et le poème de J. P. Hebel sur la conscience du caractère éphémère du temps qui passe («Die Vergänglichkeit»); comme entre le Concile lui-même et le Congrès oecuménique de 1989. Mais ce qui fait surtout le charme de ce livre, c'est son caractère narratif qui, loin de réduire l'histoire à des structures pures et abstraites, la transforme en récit et évoque à travers elle toute la vie riche et colorée du passé bâlois et européen, en insistant sur les thèmes et les enjeux eux-mêmes.
L'intérêt qu M. Berchtold porte précisément à la diversité de l'histoire suisse se retrouve encore dans le choix des sujets des nombreux articles qu'il écrivit, et dont je ne citerai ici que quelques exemples: Bràker, «le pauvre homme du Toggenburg», le fascine tout autant qu'Emile Jacques-Dalcroze ou Claparède, Pestalozzi ou Jean Piaget. Il lui est même arrivé de jeter un pont linguistique supplémentaire en rédigeant certaines de ses études en allemand, — et l'on ne s'étonnera pas si les sujets ainsi privilégiés sont Guillaume Tell, ou encore le Saint-Gotthard.
Si la gamme des sujets traités ressemble à une véritable corne d'abondance, l'activité du conférencier présente pour sa part une variété au moins aussi riche, en particulier en ce qui concerne le cadre ou le public auquel il choisit de s'adresser. Aux cours universitaires que j'ai déjà mentionnés s'ajoutent en effet les conférences publiques données dans plusieurs villes de Suisse, la participation aux cours de perfectionnement destinés aux enseignants du niveau secondaire, ou encore la participation à des séminaires organisés par les théologiens. C'est toujours le saisissant don du verbe du conférencier enthousiasmé par son sujet qui assure à ses conférences leur effet stimulant. Par cette activité d'orateur, M. Berchtold jette des ponts non seulement entre les différentes régions de notre pays (y compris le Tessin), mais encore entre l'Université et l'enseignement secondaire, ou encore entre la communauté des chercheurs et le public plus large. Si Alfred Berchtold se sent une «mission helvétique» — comme je l'ai entendu le dire lors de notre première rencontre il y a plus de vingt ans —cette formule ne doit pas laisser supposer qu'il se confine à l'intérieur de la culture suisse. La «mission helvétique» telle que Berchtold la comprend déborde largement au dehors de nos frontières, et cette culture suisse à laquelle il est si profondément attaché suppose aussi un attention permanente aux liens qui l'unissent aux autres pays d'Europe, comme par exemple l'Italie, témoignant du fait que cette ouverture sur l'extérieur est l'une de ses composantes les plus caractéristiques. Même si cela peut sembler banal, il n'est peut-être pas inutile de souligner l'importance toute particulière que revête un tel effort de jeter des ponts entre les différentes cultures d'un pays, à un moment de crise mondiale où la tendance négative serait plutôt de dissoudre des unités et de régresser vers des entités isolées et repliées sur elles-mêmes.
Enfin il y a un dernier aspect que je voudrais mentionner dans cette tentative de jeter des ponts: il y a, dans l'activité de M. Berchtold, une part d'action et de passage de la théorie à la pratique. Très souvent il a mis son don d'orateur au service de la lutte pour la conservation de l'héritage genevois. Les conférences du mois de mai dernier contribuaient ainsi au financement de l'église de Saint-Gervais.
Il y a une métaphore, sûrement très ancienne mais toujours très belle, qui me vient spontanément à l'esprit quand je pense aux activités du chercheur et de l'enseignant Alfred Berchtold: c'est l'image du feu sacré. Ce sont des personnalités dont l'oeuvre est consacrée par un tel feu que notre donatrice a voulu couronner, et c'est pourquoi nous sommes heureux, cher M. Berchtold, de pouvoir vous remettre le prix Brandenberger.
Jeter des ponts culturels
Alfred Berchtold
L'heure est pour moi à la reconnaissance. Reconnaissance envers la Fondation Brandenberger pour l'immense surprise qu'elle m'a faite par ce cadeau exceptionnel.
Lorsque j'ai reçu la nouvelle, cet été à Loèche-les-Bains, le choc a été tel que pendant quelques jours je titubais entre piscines et baignoires jusqu'à ce que j'aie pu enfin me ressaisir et me donner l'allure digne d'un lauréat, d'un würdevoller Preisträger.
Reconnaissance, dis-je, à chacun des membres de cette Fondation et de son jury, et tout d'abord, bien sûr, à Mme Renate Böschenstein. Certes je me réjouissais d'entendre ce qu'elle allait dire, mais je n'imaginais pas que ce serait si plein, si généreux, si beau. Naturellement, en de telles occasions on n'évoque que les lumières, on oublie les ombres. Dans le blason de Racine (rat-cygne) on ne contemple que le cygne et on escamote le rat. Mais, compte tenu de l'éclairage particulier d'un tel jour, que cela fait du bien, que cela est encourageant!
Ceci, je ne pouvais l'écrire d'avance, puisque je ne savais pas ce que dirait Mme Böschenstein, mais ce que j'ai déjà confié à ces feuillets, c'est l'expression de ma vive gratitude pour tout le temps que Mme Böschenstein m'a consacré, temps de lecture dans mes ouvrages, temps de rédaction de son discours, temps dérobé à sa propre activité créatrice et critique.
Nous ne serions pas réunis ici, vous et moi, sans un concours de circonstances que je crois devoir vous exposer brièvement, parce qu'en le faisant je pourrai dire, de vive voix ou en pensée, merci à tant de personnalités qui ont orienté mon chemin, qui m'ont aidé, encouragé et stimulé; et je reconnais aujourd'hui que ceux-là mêmes dont je pouvais penser à certaines heures qu'ils me mettaient des bâtons dans les roues ont finalement rendu le plus grand service à la cause à laquelle je me suis voué.
C'est à Zoug que bat le coeur de la Fondation Brandenberger. Coïncidence ou convergence? C'est de Zoug que M. Karl Gyr a envoyé à Paris mon père, fils de paysans zurichois, pour qu'il ouvre le marché français aux compteurs électriques Landis & Gyr. Grâce à quoi j'ai passé mes quinze premières années à Montmartre, entre le Moulin et la Galette et le Lapin à Gill, où j'ai eu la double chance de bénéficier d'une enfance bilingue (bilinguisme à l'alsacienne: Hol e chli jambon — Bring mr die chaise) et d'être confié au corps enseignant de la troisième République, instituteurs de l'Ecole communale et professeurs du Lycée Condorcet, dont la consécration, la conscience professionnelle, dans les conditions matérielles que l'on sait, étaient admirables.
Et puis à Paris, âgé de 7, 8 ou 9 ans, j'avais l'occasion — ce qu'ignoraient naturellement les membres de la Fondation qui me comble aujourd'hui — de voir un Suisse de l'étranger exemplaire, M. Brandenberger. C'est le premier grand homme que j'ai vu de près, si accueillant, si amical. Et M. Brandenberger, qui «sponsorisait», comme on dit aujourd'hui, un journal d'enfants de type nouveau, nommé «Benjamin», a poussé mes parents à m'y abonner. «Benjamin» fut une des sources premières de ma connaissance de l'histoire, ou du moins d'une certaine histoire. D'autre part, ce journal organisait des fêtes où l'on entendait les meilleurs représentants de la chanson française, de chanteuses réalistes inoubliables au jeune Charles Trenet. Vous voyez ce que doit mon enfance à M. Brandenberger, qui me retrouve, que je retrouve aujourd'hui après bientôt 60 ans.
Retour au pays en 1940 d'un petit Suisse de l'étranger demeuré lié affectivement à la France où son père est resté durant les années de guerre, et qui passa brusquement de l'école française au gymnase germanophone de Zurich. La Suisse ne le passionnait pas outre mesure. La Suisse, a-t-on pu dire, n'est pas un pays à passionner les jeunes. La Suisse est un pays pour quinquagénaires. Et encore, si aujourd'hui ces quinquagénaires universitaires ont la nostalgie des années 68, la relation affective au pays profond n'en est pas simplifiée.
Une forte impression de ces années 40: le débat public au Hallenstadium Oerlikon, devant des milliers de jeunes, entre le pasteur Lüthy et le conseiller fédéral von Steiger, sur la question terrible de l'accueil, du non-accueil, du refoulement des réfugiés juifs. C'est là qu'est tombée la parole de la «barque pleine».
Et puis un maître d'allemand qui nous a imposé (entre autres et combien je lui en suis reconnaissant) la lecture intégrale du «Grüner Heinrich» de Gottfried Keller et de deux grands, de deux longs romans de Jeremias Gotthelf.
Eté 1944. La maturité en poche à l'heure de la libération de Paris, mais la guerre se prolongeant, que faire, où aller pour se préparer à enseigner le français à Zurich? Le Neuchâtelois Charly Clerc, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale, et remarquable trait d'union entre la Suisse romande et la Suisse allemande, dit au futur étudiant: «Lausanne, c'est bien. Mais à Genève enseigne Marcel Raymond: il faut aller à Genève». — Je pensais m'y rendre pour deux semestres, et j'y suis encore, en mon 96e semestre.
A Genève, étude de littératures française, allemande et italienne, sans penser particulièrement à la Suisse. Mais grâce au professeur Bohnenblust, approfondissement de la connaissance des grands écrivains alémaniques, cependant que s'impose à moi, à la veille de sa mort, la grandeur de Ramuz.
Et brusquement un choc. La révélation, grâce aux conférences fulgurantes de l'historien d'art français René Huyghe, des relations entre l'art et la littérature.
En séjour chez mes parents revenus à Paris, je recherche dans un almanach des Suisses de l'étranger une étude sur le peintre Hodler. Et voici que je tombe par hasard, à 22 ans, sur l'article d'un écrivain que je ne connais pas, qui traite des lignes de force, des caractères spécifiques de la vie culturelle helvétique et qui me révèle comme en un éclair que ce pays, qui est le mien et qui me laissait indifférent, a un visage, des richesses, des dimensions que je n'avais jamais vu présenter de façon synthétique. Tout à coup m'apparaît ceci contrairement à ce qui se passe dans les nations qui nous entourent, on peut chez nous être cultivé, avoir sa maturité, sa licence, son doctorat et être ignorant de la vie profonde — littéraire, artistique, scientifique, religieuse — de son propre pays, à commencer bien sûr par les régions parlant une autre langue que la nôtre. Comme d'autres Suisses de l'étranger j'étais sans doute préparé, plus que le Suisse de l'intérieur, à envisager le pays — cette terra incognita dans son ensemble et, une fois l'étincelle provoquée, à me lancer à la découverte de chaque canton avec la même curiosité, la même sympathie et, j'ose le dire, la même allégresse.
Mes premières conférences publiques à Genève traitèrent — c'était au Buffet de la Gare — des Grisons et du Tessin. Mes premiers articles dans le «Journal de Genève» (avant d'y donner des portraits de peintres) présentèrent des ouvrages de Suisse allemande, comme le faisait un cours que m'avait confié l'Ecole de Bibliothécaires. Ma thèse de doctorat, dirigée avec une compréhension aussi bienveillante qu'exigeante par le professeur Marcel Raymond — il me disait «abaissez la température de quelques degrés; on ne peut pas brûler sur mille pages'» —, cette thèse fut, comme l'a rappelé Mme Böschenstein, consacrée aux lettres de Suisse romande. Mais je compris que je ne pourrais me borner à la littérature au sens strict du terme (poésie, roman, théâtre) et qu'il me fallait — sans parler des autres arts (les personnalités de Hodler, Appia, Jaques-Dalcroze, Ansermet) — étudier aussi et d'abord la vie spirituelle, les traditions religieuses, protestante, catholique, juive. Le terme de familles spirituelles (au pluriel) a toujours représenté beaucoup pour moi, d'autant plus qu'il m'est vite apparu qu'à étudier ces familles j'étais naturellement conduit au-delà des frontières. Ni le protestantisme, ni le catholicisme, ni le judaïsme ne pouvaient s'étudier en vase clos. D'ailleurs l'étude approfondie de chacun de nos cantons ne peut que mener également à des périples européens — et plus qu'européens. Bonheur de voir s'ouvrir à chaque pas de nouveaux horizons.
Il n'y a pas de compréhension de la vie culturelle de ce pays sans l'étude de la présence étrangère en Suisse et celle de la présence suisse à l'étranger. A ce propos il convient de citer ici, a côté de personnalités telles qu'Auguste Piccard, Arthur Honegger, Blaise Cendrass, Le Corbusier ou Brandenberger, celle du lauréat du Prix Brandenberger de l'année passée, le jardinier inspiré René Daniel Haller, qui accomplit au Kenya une oeuvre admirable d'aide au développement.
«Mais, je demanderez-vous, quel était l'écrivain qui vous a lancé à la découverte du pays et dont l'article de quelques pages a décidé de l'orientation de votre vie?» — C'était Gonzague de Reynold. Alors, voyez comme c'est intéressant: Reynold, dont je devais découvrir plus tard la pensée politique et certaines options que je ne pouvais approuver, Reynold, cet homme situé à l'extrême droite de notre éventail politique, par l'élan qu'il m'a donne, par la curiosité qu'il a éveillée en moi, m'a fait découvrir des hommes tout différents de lui, tels que Denis de Rougemont, Albert Béguin, Pierre Ceresole, ou le théologien grison Leonhard Ragaz, dont le biographe se trouve parmi nous. Le catholique Reynold m'a mené vers le protestant Vinet et indirectement vers l'émouvant auteur juif Edmond Fleg. La longue quête que j'ai menée auprès des penseurs, artistes, écrivains, théologiens de ce pays — sans oublier Dada et le Cabaret Cornichon — m'a fait rencontrer des hommes et des femmes d'une diversité infiniment stimulante, et celles et ceux qui m'ont aidé dans mon travail avaient un passé ou un présent politique, religieux, idéologique également différent. — Que dire enfin de mes visites chez les peintres et sculpteurs, d'Albert Schnyder à Aldo Patocchi, de Hans Berger à Giacometti? Que dire de l'amitié bienfaisante de tels musiciens ou de celle d'un artiste tel qu'Emil (Emil Steinberger de Lucerne)?
Rencontres. Begegnungen. Nous sommes ici au coeur du problème. Pour rendre justice au pays, pour le rendre aimable au sens le plus fort du terme (liebenswert), pour faire de l'Eidgenossenschaft un véritable Eidgenuss, il ne suffit pas de brandir des formules, telles que fédéralisme, cantonalisme, démocratie directe, etc. Il faut les vivre. Il faut du concret, il faut la chaleur des relations humaines; il nous faut un pays habité par des présences: des paysages bien sûr, mais surtout des visages. Il nous faut des rencontres inspiratrices. Ramuz, dont un des livres s'intitule «Besoin de Grandeur», a dit du pays de son oeuvre: «Ce pays, je l'ai peut-être inventé, parce que j'en avais besoin.» Quant à moi, je n'étais ni capable ni désireux d'inventer un pays, mais j'éprouvais l'exigence d'une patrie satisfaisant aussi les besoins intellectuels, spirituels, esthétiques, besoins auxquels ne répondaient vraiment ni les clichés politiques, ni les accents du Männerchor de Steffisburg. Or cette patrie existe, même si l'école ne trouve en général pas le temps de nous la révéler autrement que par quelques fragments. Si l'on se donne le temps de bien chercher, on découvre dans chaque village le passage du poète, au sens large, ramuzien ou gotthelfien du terme, cet-à-dire le passage du créateur, du constructeur, de l'inventeur, de l'artiste, voire du prophète — et plus d'une fois il s'agit d'un étranger, d'un réfugié. Et de tous ces villages sont partis des hommes et des femmes à qui le pays n'avait pu fournir leur nourriture, et qui ont dû chercher ailleurs, souvent très loin, la possibilité de subsister d'abord, et parfois celle de se réaliser pleinement dans une oeuvre. Terrible et bouleversante histoire des Suisses de l'étranger, à commencer par celle de l'émigra-tion tessinoise ou engadinoise!
Le physicien et prix Nobel Oppenheimer a dit un jour que le grand problème de notre temps serait de tenir les deux bouts de la chaîne: mon village et le monde. Nous avons la chance de posséder une patrie qui ne se suffit pas à elle-même, qui ne peut pas comme d'autres pays se croire le centre du monde. Nous avons la chance d'avoir une histoire culturelle liée, comme notre histoire économique, par mille canaux à celle de l'Europe et des autres continents. Mme Böschenstein a bien voulu parler de mon livre «Bâle et l'Europe«, mais si la vie était plus longue et si je travaillais moins lentement, j'aurais voulu écrire «Genève et l'Europe», «Zurich et l'Europe», «Saint-Gall et l'Europe», «Soleure et l'Europe», «Ascona ou Lugano et l'Europe». Non, il n'y a pas d'un côté l'Europe et de l'autre la Suisse. Dès les origines, avant notre histoire politique, avant la Réforme, avant le concile de Bâle, avant la «Manesse Handschrift» de Zurich, avant les grandes heures du couvent de Saint-Gall, avant la légion thébaine de St-Maurice, nous voyons cette terre — comme toutes les terres après tout — traversée par des courants divers de civilisation. Je ne cesse de relire avec joie et reconnaissance la page magnifique que le professeur Jean Starobinski a consacré — dans son discours de Bellinizone — à nos chemins montagnards inseparables de l'histoire de nos origines. Chemins d'Europe. Oui ce pays de cols et de tunnels nous mène sans cesse à la rencontre de l'autre, de celui qui me heurte, me déconcerte, m'intéresse parce qu'il est à la fois semblable et différent. Ce pays de faiseurs de lexiques, de glossaires, de traductions, de constructeurs (en Suisse et dans le monde) de ponts de bois, de pierre, de fer et de béton, ce pays qui est une petite Europe a quelque chose à apporter à la grande Europe, comme il a à recevoir d'elle, — à condition de ne pas commencer par vider son Rucksack, par se renier soi-même. Encore une fois, l'Europe est faite de ce que chacun lui apporte. Il ne suffit pas de se faire rien, comme le voudraient cer-tains, pôur devenir de bons Européens.
Bien sûr, il faut l'esprit critique. On n'oublie pas le mot de Spitteler: «Les Suisses sont si fiers de leurs montagnes, mais s'ils les avaient cons¬truites eux-mêmes, elles seraient sans doute beaucoup plus plates.» Il est heureux qu'à une histoire souvent trop complaisante, qu'à une patriotische Schönmalerei ait succédé une historiographie plus exigeante, plus critique. D'ailleurs tous nos grands écrivains ont prononcé à l'occasion des jugements sévères sur ce pays, mais, comme le disait M. Starobinski, il convient de distinguer soigneusement l'esprit critique, indispensable devant certaines injustices, lâchetés, trahisons, de l'esprit de dénigrement systématique. Relever les beautés, les valeurs demande autant d'intelligence et parfois de courage que l'énumération des défauts. Sachons toujours distinguer entre l'ironie agressive qui humilie les autres et l'humour cordial qui se met soi-même en question. Souvenons-nous de la huitième Béatitude proposée par ce pasteur vaudois: «Heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, car ils n'ont jamais fini de s'amuser».
D'autre part le développement heureux de disciplines telles que l'histoire économique, sociale, agraire, la statistique, l'histoire des mentalités, qui nous révèlent les pesanteurs, les servitudes et les souffrances de la vie collective, ne rend pas inutile la présentation de ces biographies, où manque rarement l'anecdote significative qui, dans une image, dans un sourire, résume une situation, un caractère, une destinée: ces biographies à la fois admiratives et critiques, exemplaires souvent par leur part d'ombre autant que pour leur part de lumière, que l'un des fondateurs de l'école laïque française recommandait avec tant d'insistance aux futurs enseignants. Souvent une vocation a été allumée par une biographie. Durant la dernière guerre, c'est à cause de Pestalozzi et de Dunant que certaines et certains se sont donnés à la cause des réfugiés. Je crois à la nécessité de mieux connaître les personnalités de grands Européens que la Suisse a produits. Je crois surtout qu'au moment où nous sommes appelés à regarder vers le large, à nous ouvrir à des perspectives plus vastes, à relativiser peut-être le sens de nos frontières, il est d'une urgence extrême de prouver notre vocation européenne par une fidélité plus grande, par un attachement plus affectueux à tous les signataires du Pacte, à tous les membres de la famille helvétique. Nous ne serons des Européens crédibles qu'à condition de faire aussi plus décidément nôtres les soucis du pays d'Uri et du Tessin, les inquiétudes des Grisons, les joies de l'Appenzell.
Un mot pour finir. Ce que la Fondation Brandenberger honore, c'est, à travers tel ou tel individu, la cause à laquelle il s'est voué. Lutte contre la torture du professeur Hans Haug, aide au développement de M. René Daniel Haller, maintenant essai — qui n'a rien d'unique — de lancer des ponts culturels — si j'ose dire entre diverses régions du pays, entre les Suisses d'aujourd'hui et leur passé, entre le travail des spécialistes ou l'oeuvre des créateurs de beauté et le public cultivé. De cette attention de la Fondation, comment ne pas être profondément reconnaissant? Mais qu'il me soit permis de confesser que, dans mon activité, j'ai été un privilégié — dans mes succès comme dans mes échecs apparents. Admirablement aidé par ma femme et par tant d'amis, parmi lesquels je compte les équipes de mon éditeur, je n'ai pas été continuellement astreint à un enseignement secondaire ou universitaire à plein temps, qui, compte tenu de mes limites, m'aurait empêché de faire les conférences, d'écrire les livres et articles que j'ai pu préparer longuement. Je tiens aussi à dire ici que je n'ai jamais pensé qu'une liste de publications présentât une valeur supérieure à celle du travail quotidien de l'enseignant consciencieux, du formateur, de l'éveilleur d'esprits. Aussi serais-je heureux — et des contacts à ce sujet ont déjà été pris — que la somme qui m'est confiée puisse servir à favoriser des rencontres, à encourager des jeunes chercheurs dans le domaine qui est le mien, à ménager un contact plus intime entre les citoyens de ce pays et leur héritage spirituel.